
Le 1Hebdo propose un numéro dédié à Pierre Bourdieu, éminent sociologue du XXe siècle, issu d’une famille modeste et qui après avoir étudié le phénomène de colonisation sur le peuple algérien est revenu en France pour traiter du système de l’éducation. Il est à l’origine de plusieurs grandes notions qui traversent encore nos recherches actuelles : la reproduction sociale, le capital culturel ou encore la violence symbolique.
Source et lecture conseillée : Numéro 405 de l’hebdomaire Le Un, mercredi 13 juillet 2022.
Biographie de Pierre Bourdieu, sociologue
Pierre Bourdieu (1930-2002) est fils d’une famille modeste de paysans béarnais. Il a un frère, Albert, et une sœur, Noémie. Son parcours éducatif l’emmène dans un lycée de Pau, en ville, un lieu qu’il ne connait pas, et un lycée remplit de bourgeois. Même histoire lorsqu’il intègre plus tard les classes préparatoires du lycée Louis-le-Grand à Paris : une première expérience de la domination. En 1954, Bourdieu est agrégé de philosophie et enseigne au lycée de Moulins, avant de devoir du fait de la conscription partir en Algérie coloniale. Il est plus particulièrement affecté au gouvernement général d’Alger et a pour mission de recherche de comprendre comment le système colonial touche la vie des Algériens, notamment en Kabylie. Plus précisément, il étudie comment le capitalisme colonial imposé à la société kabyle modifie les structures traditionnels de la société, plus généralement comment s’effectue cette transition économique en contexte de colonisation et de guerre. En 1960, il revient en France et dirige le Centre de sociologie européenne en 1961 en étant assistant du libéral Raymond Aron. Intellectuel accessible, il prend chacun et chacune pour son égal et sa bibliothèque contient autant de sociologie, de philosophie que d’histoire. Ses travaux sont associés à de nombreuses méthodes : la théorie et la pratique par le biais des statistiques, des entretiens, des enquêtes, des lectures… En 1975, à une époque où la sociologie est encore peu diffusée et s’impose peu, il fonde avec l’historien Fernand Braudel, connu pour ses travaux sur la Méditerranée, une revue savante consistant à diffuser le savoir des sciences sociales : Les Actes de la recherche en sciences sociales. En 1982, il occupe la chaire de sociologie au Collège de France. À partir des années 1990, l’intellectuel s’engage dans le militantisme de la gauche radicale, par la publication d’écrits comme La misère du monde en 1993 dans lequel il décrit les effets néfastes du capitalisme et du libéralisme économique, ou sur le terrain en participant aux manifestations en 1995 contre la réforme des retraites des fonctionnaires. Proche de Rocard et de Mitterrand et des gouvernements de gauche, il a très vite perdu confiance envers cette gauche qu’il ne trouvait pas assez radicale, qui préférait s’adapter et adopter le modèle libéral. En 2002, il décède d’un cancer.
Reproduction sociale, capital culturel et violence symbolique
On doit à Pierre Bourdieu de nombreuses notions qui sont encore incluses dans les recherches françaises et européennes aujourd’hui. Celle de reproduction sociale – c’est-à-dire la conservation du même statut social d’une génération à l’autre – qu’il a étudiée notamment à travers le parcours scolaire des plus jeunes. Bourdieu affirme ainsi que l’école maintient et cultive la reproduction sociale. En effet, l’école a selon lui des attentes spécifiques comme un capital culturel qui sont des connaissances, des codes et des valeurs. Or ce capital culturel est majoritairement bourgeois : une manière de parler, de se tenir, des connaissances davantage dans ce domaine que d’autre, une pratique plus qu’une autre… En conséquence, ceux qui réussiront le mieux à l’école sont ceux pour qui ce capital culturel est aisé à avoir, c’est-à-dire de parents qui l’ont déjà, qui ont réussi leur vie et qui entretiennent l’éducation de leurs enfants – donc des parents qui sont très souvent plus aisés. Ainsi, Bourdieu affirme l’idée que ce capital culturel empêche l’ascension sociale à travers l’école, et fait de l’école un lieu de reproduction sociale. Les inégalités socio-économiques font encore la loi. Cette ascension empêchée se reflète dans la société où les classes populaires ont tendance dans les années 1960 à s’auto-exclure de l’école (c’est d’ailleurs le grand phénomène des bandes de jeune pour qui l’économie symbolique se jouait davantage dans la rue, plutôt que sur les bancs de l’école). Par auto-exclusion, on entend l’abandon ou l’arrêt de travail qui crée une situation d’échec scolaire, ou encore la décision de ne pas prendre des parcours éducatifs qui ont la réputation difficile parce qu’il y a une mésestime de soi et de choisir ou imposer aux élèves moins bons des parcours jugés plus faciles (voie professionnelle, technologique…). Bourdieu appelle cela la violence symbolique, elle n’est pas physique mais empreint la société par des représentations. Depuis, ce phénomène s’est atténué car le capital culturel demandé à l’école est moins fort et ce qui fait la différence dans les parcours éducatifs est la différence de richesses entre les familles qui permettent aux unes et non aux autres d’offrir les parcours éducatifs possibles – bien qu’ils soient payants ou sur sélection, etc. Il s’est également atténué par l’ouverture sociale des plus grandes écoles à travers par exemple l’accueil d’un pourcentage de boursiers. Néanmoins, depuis Parcoursup et son système opaque de sélection, de tri, de hiérarchisation entre les filières, les diplômes et les établissements, les inégalités sont plus nombreuses et cette violence symbolique plus forte.
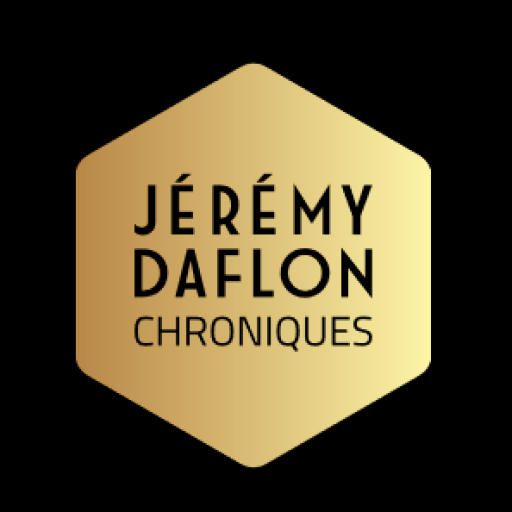
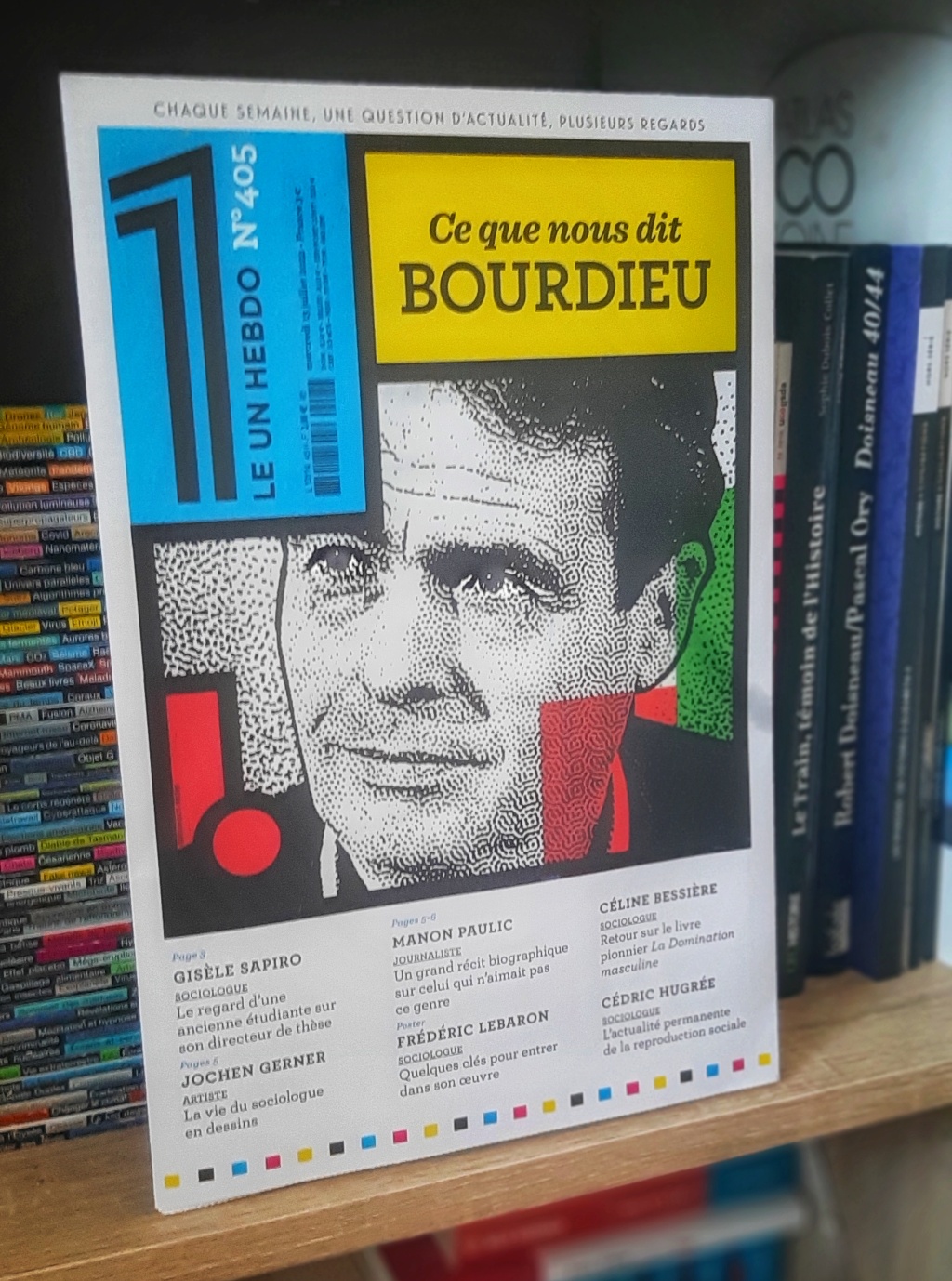

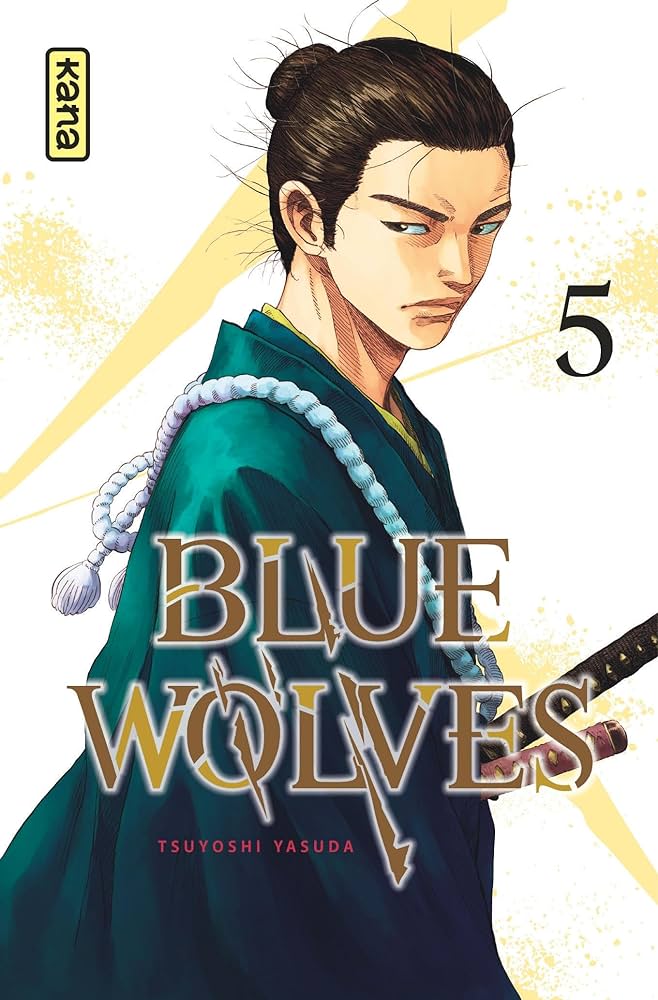
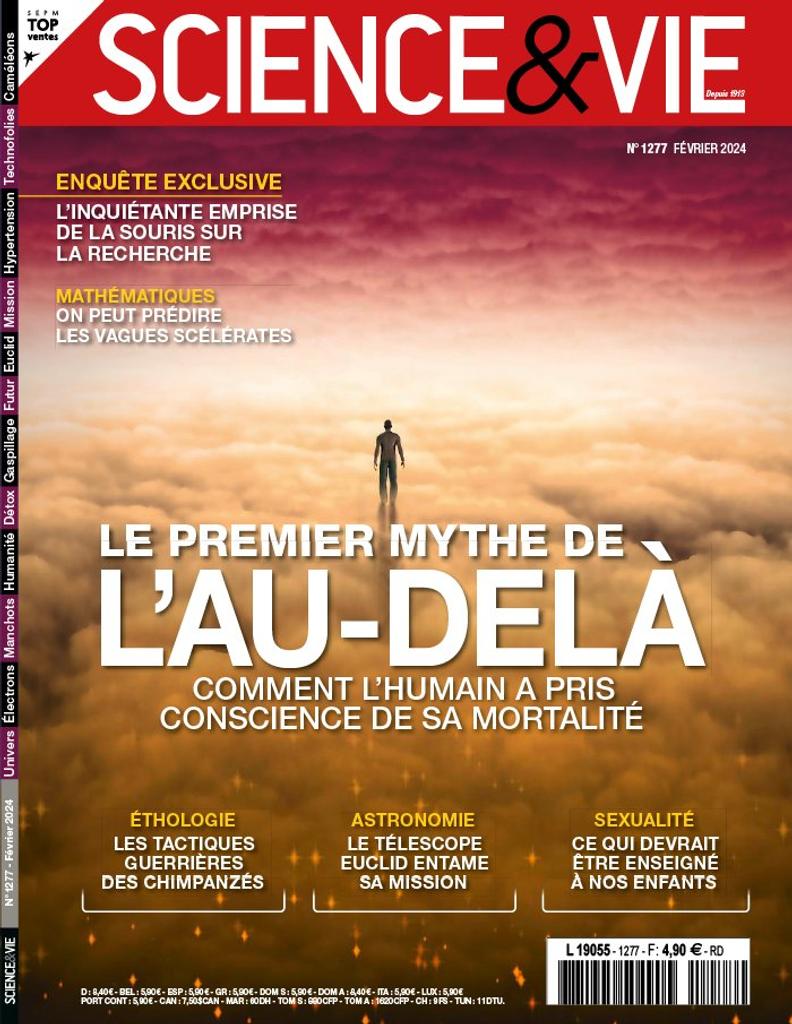
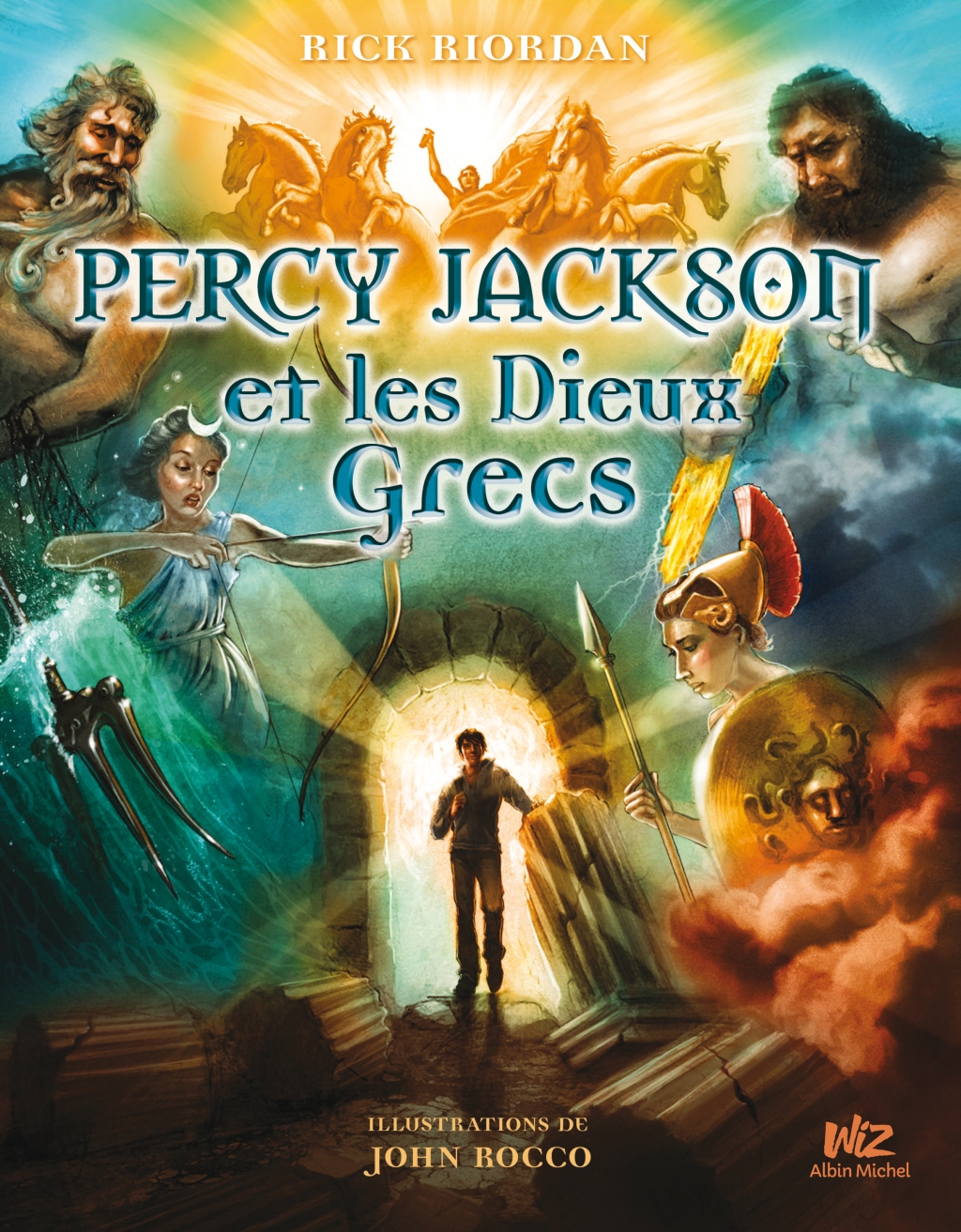
Laisser un commentaire